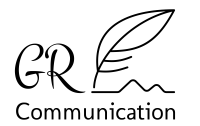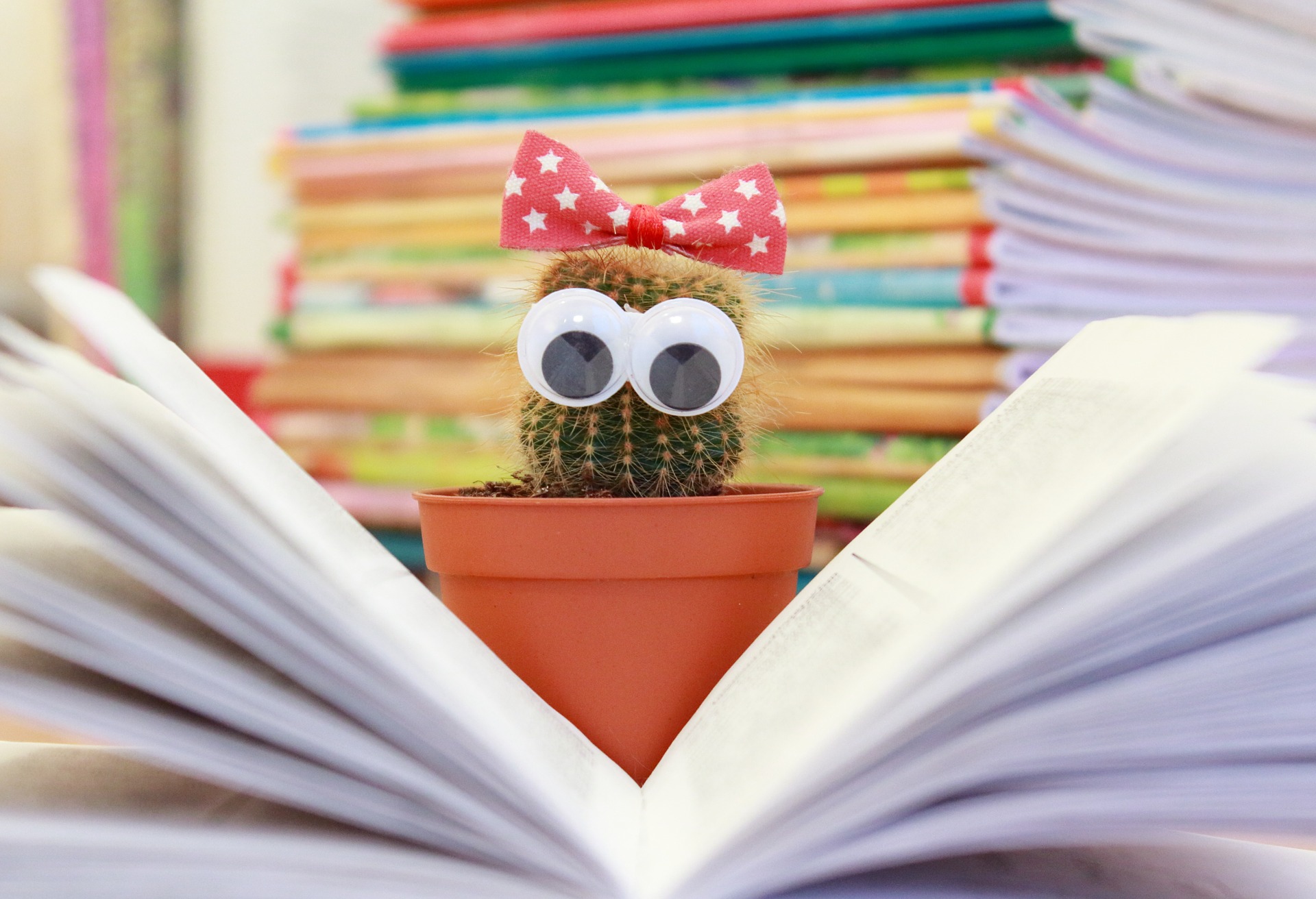
La révision linguistique a été pendant longtemps une activité méconnue, peu demandée et parfois même méprisée. Encore dans les années 70, elle faisait partie intégrante du processus de rédaction des scripteurs. D’après mes constats, seules des entreprises d’envergure, des organisations publiques et des maisons d’édition voyaient l’intérêt d’engager des réviseurs linguistiques comme salariés et plus souvent comme pigistes. En vérité, toute entreprise devrait avoir dans son équipe une ressource aussi indispensable.
Depuis les années 2000, les réviseurs ont fait du chemin. Ils ont réussi à se faire reconnaître et à se faire une place sur le marché de l’emploi, entre autres, grâce à la parution d’études et d’ouvrages divers sur le métier et aux actions de l’Association canadienne des réviseurs. Mais la route est encore longue. Bien des documents, des outils de communication, des articles de journaux, des textes de revues et magazines, des livres et surtout des contenus Web sont remplis de fautes de tous types, preuve que les besoins en révision linguistique ne sont pas tous comblés.
Concrètement, que font les réviseurs?
« Le réviseur linguistique, disait l’écrivain Éric Dupont lors d’une entrevue à Radio-Canada, à part corriger les fautes d’accord, les anglicismes, les fautes de syntaxe, c’est aussi celui qui va faire en sorte que la voiture que vous avez identifiée en page 14 comme une Ford ne devient pas une Chrysler à la page 142. » Et il avait raison. La révision linguistique comprend non seulement la correction des fautes (grammaire, langue, ponctuation, style, uniformité, etc.) mais également, la restructuration des idées et la réécriture. Nous, les réviseurs, sommes de véritables Sherlock Holmes qui allons à la poursuite des bons termes, des bonnes orthographies des références ou encore de l’exactitude des informations apportées par les rédacteurs. Nous devons faire preuve d’attention, notre qualité première, et surtout de jugement, notre but n’étant pas de trouver des erreurs à tout bout de champ. Après tout, ce qui nous importe, c’est de remettre un texte de qualité, cohérent, intelligible – c’est-à-dire, facile à comprendre – et dénué d’ambiguïté.
Les trésors des réviseurs
Nous avons sans équivoque des connaissances approfondies sur les règles qui régissent la langue française. Avec le temps, nous acquerrons un vocabulaire riche et spécialisé dans un domaine de prédilection. Mais « nul ne peut prétendre maîtriser la langue dans son immensité, dans sa mouvance », écrivait Marie-Éva de Villers. Il est donc légitime, et même recommandé, que nous puisions dans les ouvrages et outils de référence les règles d’emploi des termes utilisés dans un texte.
En format papier ou numérique, gratuit ou payant, ces outils peuvent être utiles à tous. En voici quelques-uns :
- Les dictionnaires : Larousse, Le petit Robert, Usito, Les Dictionnaires, Le grand dictionnaire terminologique
- Le bon usage
- Le Bescherelle
- La Banque de dépannage linguistique
- Antidote
- Le Trésor de la langue française informatisé
Un travail de collaboration
La collaboration avec les donneurs d’ouvrages, les rédacteurs et dans certains cas, les spécialistes du milieu concerné est primordiale. Tous ces professionnels sont, en effet, les mieux placés pour répondre aux questions que nous pourrions avoir. À titre d’exemple, si certaines parties des contenus sont plus ambiguës que d’autres, je dois comprendre l’intention du rédacteur avant d’y apporter des corrections ou modifications. Il en est de même pour la terminologie, pour des textes plutôt techniques. Évidemment, je pourrais m’approprier les termes en faisant les recherches adéquates, mais des explications provenant de spécialistes du milieu seraient bien plus bénéfiques. En outre, travailler en collaboration facilitera les ajustements par rapport au besoin du donneur d’ouvrage – souvent en évolution –, ce qui nous assure alors d’être toujours sur la même longueur d’onde.
Tu as besoin d’une réviseure linguistique ? Contacte-moi dès maintenant.